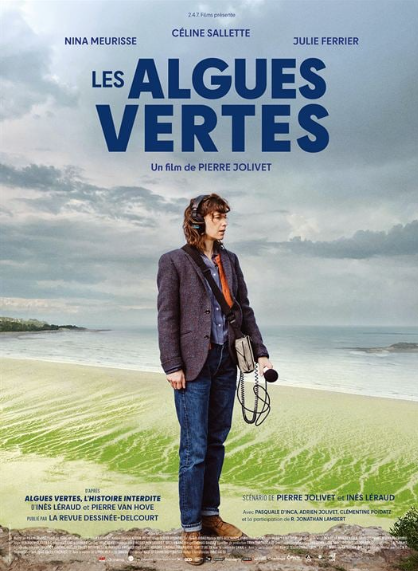Pierre Le Masne, Maître de conférences émérite d’économie à l’université de Poitiers. L’économiste Pierre Le Masne juge, dans une tribune au « Monde », les prescriptions du rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz insuffisantes pour financer le coût d’une véritable transition écologique.
« Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz intitulé « Les incidences économiques de l’action pour le climat », publié le 22 mai, propose une évaluation économique du coût d’une partie de la nécessaire reconversion écologique de la France, celle qui concerne le climat, sans évoquer les neuf questions écologiques fondamentales mises en évidence par le Stockholm Resilience Center.
Or, les « limites planétaires » ont déjà été dépassées sur six d’entre elles. En dehors du climat, le « coût économique de la transition » concerne aussi la biodiversité, l’artificialisation des terres, l’abus de nitrates et de pesticides, les plastiques, l’eau…
Mais le rapport oublie un autre point important : la prise en compte des importations. Il y est ainsi affirmé que « malgré une progression du produit intérieur brut (PIB) de 50 % entre 1995 et 2019, l’empreinte carbone de la France a diminué de 20 % sur la même période », sans parler du rôle des importations dans l’empreinte carbone.
Un document officiel publié fin 2022 dans « Données et études statistiques » dit pourtant : « Les émissions associées aux importations représentent un peu plus de la moitié (51 %) de l’empreinte. Par rapport à 1995, l’empreinte carbone de la France [en 2021] a diminué de 9 %. Les émissions intérieures se sont réduites de 27 % tandis que les émissions associées aux importations se sont accrues de 20 % ».
Le rapport surestime donc largement la diminution de l’empreinte carbone (20 % au lieu de 9 %). En fait très peu a été fait depuis 1995, si on tient compte des importations. La délocalisation de l’industrie française a joué un rôle majeur dans la diminution des émissions de CO2 sur le territoire. Mais la reconversion écologique doit au contraire favoriser une relocalisation industrielle pour réduire le coût écologique du transport ainsi que le déficit commercial.
L’investissement à l’étranger doit être contrôlé
Le rapport a l’immense mérite de préconiser un renforcement de l’investissement : il faudrait l’augmenter de 2 % du PIB par an en 2030, 67 milliards d’euros, la moitié assumée par l’État et la moitié par les entreprises. La plus grande partie, 48 milliards, concerne les bâtiments et leur rénovation. Mais si le bâtiment est sérieusement pris en compte, le reste ne l’est pas suffisamment.
Il faudrait beaucoup plus d’investissements pour améliorer le ferroviaire et la production d’énergie renouvelable, pour reconvertir le réseau électrique, mais aussi pour résoudre d’autres questions écologiques comme l’abus de nitrates et de pesticides, les menaces sur la biodiversité, la qualité de l’eau… La question écologique au sens large inclut aussi la santé et la pharmacie. L’effort d’investissement à l’horizon 2030 devrait par conséquent être plutôt évalué à 4 % de PIB de plus par an, 2 % assumés par les entreprises et 2 % par l’État.
L’importance des montants incite à réfléchir à la structure de l’investissement et de la valeur ajoutée qui en sera retirée, et par conséquent à se demander sur qui doit reposer la charge de cet investissement.
Une planification écologique doit disposer d’institutions capables de réorienter la structure sectorielle de l’investissement. Il doit être réduit dans le transport aérien, et au contraire fortement accru dans les secteurs concernés par la reconversion écologique. L’investissement à l’étranger doit être contrôlé : il doit par exemple être mis fin aux investissements de Total et de plusieurs banques dans les énergies fossiles à l’étranger.
La répartition du profit doit évoluer
Il faut aussi réfléchir à la structure de la valeur ajoutée souhaitée, et obtenir par de fortes incitations fiscales la réalisation des objectifs retenus. La part des profits des entreprises dans la valeur ajoutée est aujourd’hui très élevée, 34 % en 2021 et 31,7 % en 2022. Il faudrait qu’elle diminue pour qu’augmente la part des salaires, sinon les voitures électriques ne trouveront pas d’acquéreurs.
Par ailleurs, la répartition du profit doit évoluer, et favoriser le profit investi aux dépens du profit distribué. L’investissement des entreprises a été de 360 milliards en 2022, tandis que les dividendes distribués ont représenté 206 milliards. Une diminution d’un tiers des dividendes versés (par une taxation renforcée) permettrait d’augmenter de 68 milliards l’investissement des entreprises, ce qui correspond à 2 % du PIB en 2030.
La planification écologique doit aussi aborder la question de la croissance. Toute augmentation du PIB et de l’investissement a certes un effet initial négatif sur les émissions de CO2. Mais, si l’investissement est écologiquement bien orienté, il permet à terme de combattre le changement climatique et la perte de biodiversité.
Un programme tendanciel (jusqu’en 2050) destiné à peser à terme le moins possible sur la nature peut alors être énoncé : la productivité du travail augmente nettement, mais la croissance du PIB est réduite au niveau suffisant pour mettre en œuvre la reconversion. Grâce au renforcement de l’investissement, la productivité horaire du travail augmente de 1,5 % par an – un peu plus que le 1,3 % avancé par le Conseil d’orientation des retraites (COR) dans son rapport 2022.
Socialisation d’entreprises
Cette augmentation est consacrée pour un tiers à la réduction du temps de travail hebdomadaire (0,3 % par an) ainsi qu’à la diminution du nombre d’années nécessaire pour obtenir une retraite complète (0,2 %) : ce programme permet de diminuer la durée hebdomadaire du travail de 3 heures d’ici à 2050 (32 heures au lieu de 35) et d’obtenir une retraite complète après quarante ans de travail. Le PIB augmente de 1 % par an. Les salaires peuvent augmenter d’un petit peu plus de 1 % par an pour peu que le taux de marge des entreprises diminue légèrement.
Une planification écologique, outre la réorientation de l’investissement, doit mettre en place une réglementation exigeante concernant l’utilisation d’engrais et de pesticides ainsi que les émissions de CO2 des entreprises, avec des normes progressives ; les dépassements donnent lieu à des pénalités. Elle ne doit pas craindre la socialisation d’entreprises dont le comportement passé au regard de l’écologie et du social est désastreux : Total mais aussi certaines banques, et pourquoi pas Sanofi, afin de permettre un approvisionnement satisfaisant en médicaments.
La socialisation de banques est de toute façon nécessaire pour que l’État puisse orienter financièrement la reconversion. La fiscalité doit être revue et les prélèvements obligatoires accrus (par l’impôt sur le revenu et celui sur la fortune) pour que l’État puisse assumer les charges qui lui incombent, en recourant le moins possible à l’endettement. La charge de la reconversion écologique doit avoir une dimension sociale, reposer sur les entreprises, sur l’État et sur les ménages aisés, pas sur ceux qui ne le sont pas.
Les prescriptions du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz ne suffiraient pas, au cas hypothétique où il serait mis en œuvre, à assurer la reconversion écologique de la France. Cette reconversion exige une volonté très forte de l’État et un soutien de la population, soutien possible seulement si le programme écologique est en même temps un programme social. Mais le contexte néolibéral en Europe ne facilite pas la mise en œuvre des éléments de solution alternatifs qui viennent d’être présentés.
Pour la planification écologique
- L’urgence de la transition énergétique et l’insuffisance des instruments de marché poussent gouvernements et économistes à reconnaître à l’État un rôle majeur dans la conduite du changement.
- « Après 1945 comme aujourd’hui, l’État était la forme d’organisation collective à même d’éviter la catastrophe », par Eric Monnet, historien de l’économie monétaire et financière, directeur d’études à l’EHESS et Prix du meilleur jeune économiste 2022
- « La répartition des efforts et des gains doit être équitable », par Magali Reghezza-Zitt maîtresse de conférences en géographie à l’École normale supérieure, où elle codirige le Centre de formation sur l’environnement et la société
- « Passer d’une logique de compétition entre États à une logique de coopération », par Massimo Amato, professeur d’histoire économique à l’université Bocconi (Milan)
- « La planification écologique doit disposer d’un instrument financier : la double valorisation du carbone », par Michel Aglietta est professeur d’économie, spécialiste des questions monétaires et conseiller scientifique au Centre d’études prospectives et d’informations internationales
Pierre Le Masne (Maître de conférences émérite d’économie à l’université de Poitiers)